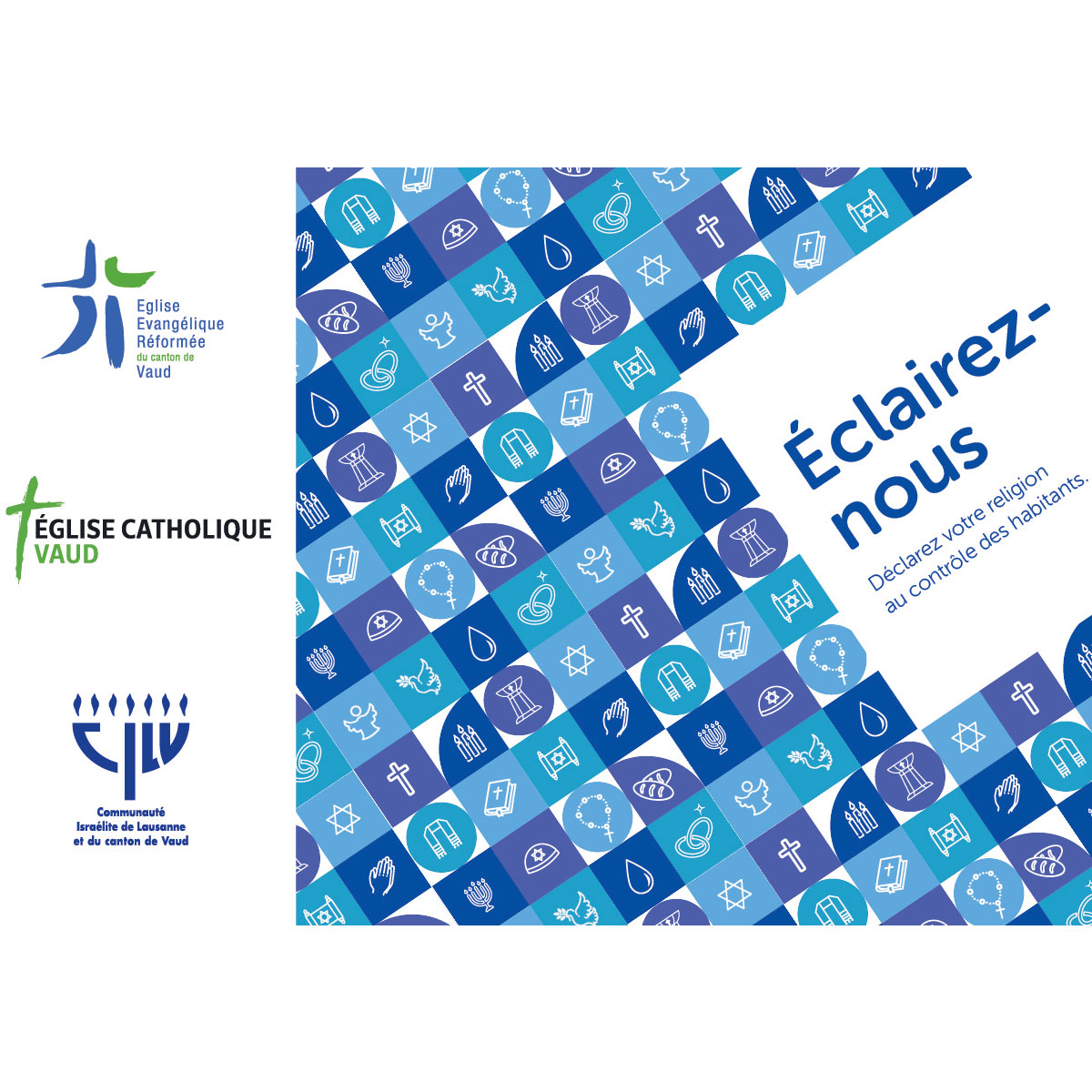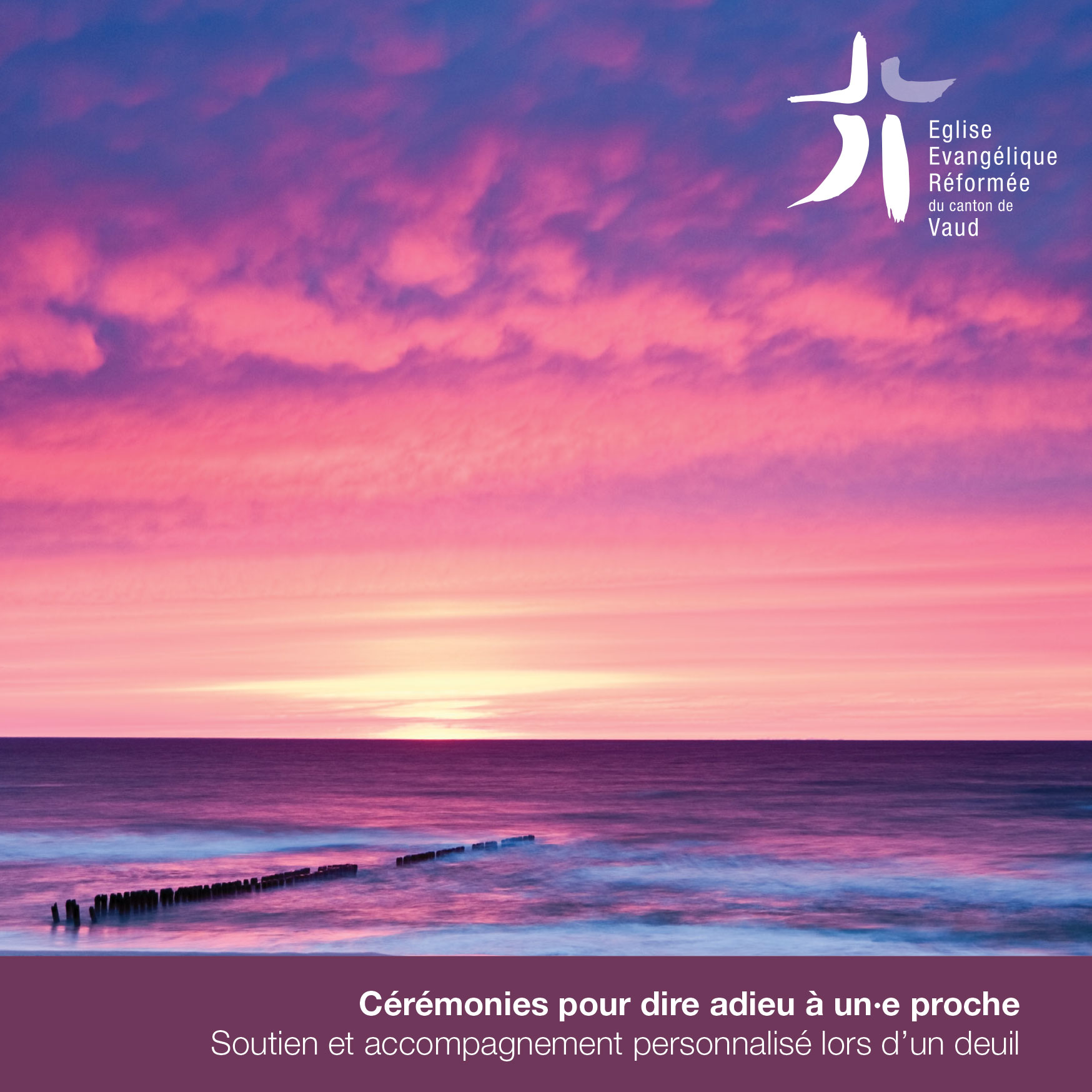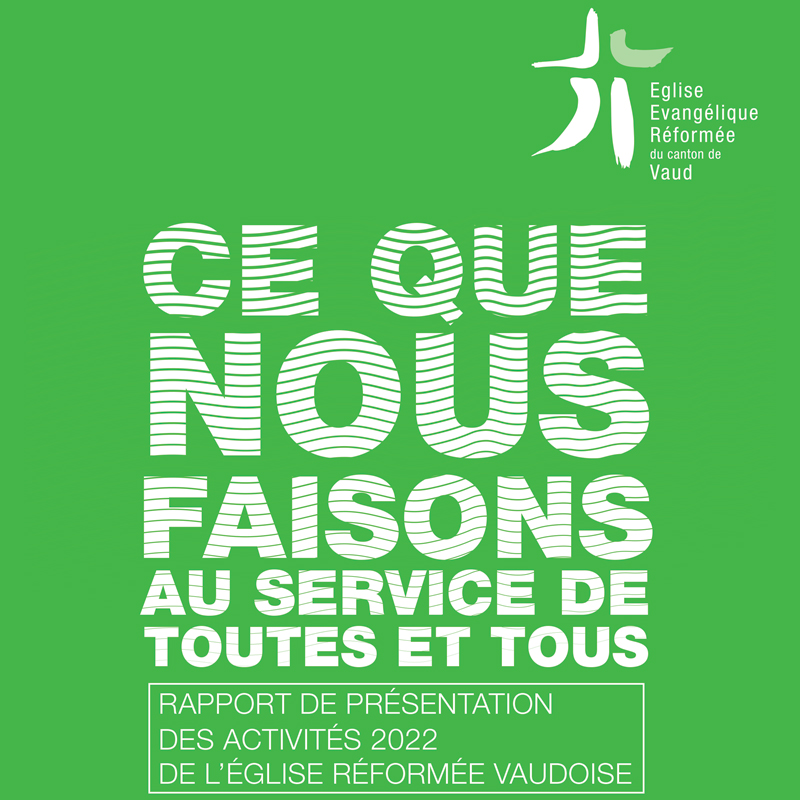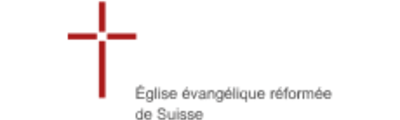Que cherchez-vous ?
Actualités
Toutes les actualités +
ProtestInfo
QuestionDieu
Nos publications
Liens utiles
Survoler les logos avec le curseur pour afficher le descriptif !